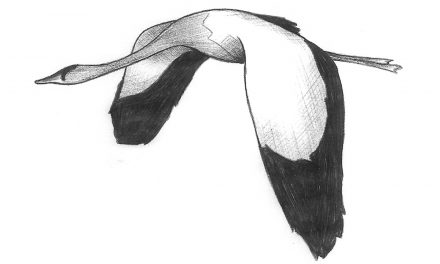Aux ruines de nos vies.
Les traverser, les arpenter, les piétiner, renaitre parfois jonché en haut d’une colonne effondrée sur elle-même. Puis trébucher à l’aube d’un éclat glissant, éboulis de pierres lestant nos omoplates, anéantissant rêves d’oubli et prières dans un fracas de souvenirs assourdissants.
Puis s’extraire, et marcher, marcher encore, marcher d’abord, aller ensuite. S’assurer que nos chevilles se dansent des décombres, que nos genoux ne flanchent pas, le torse droit, la bouche haute, haletant l’air à la surface du présent.
Si t’as la flemme de lire et que tu préfères la radio, le podcast est là, juste en dessous.
« Vas-y, le gars il se prend pour un Slammeur. »
Nan, la poésie c’est pour appâter le chaland, pis moi c’est plutôt Gros Corps Malade. Enfin c’est comme ça que me culpabilise mon médecin : « Oui je sais les antidépresseurs, l’hécatombe de vos proches, le stress… Mais monsieur il faut faire de l’exercice ».
Mais va bien te faire cuire le cul avec ton stéthoscope dans l’oeil ! Si moi j’ai envie de sentir passer le chagrin, si je trouve nécessaire de déprimer sur mon canapé à jouer à la console et bouffer des gâteaux.
Oui, vous allez me dire que je ne peux pas me laisser aller, que ce n’est pas à la société de payer pour la désagrégation de ma santé. C’est vrai que votre vision du bonheur obligatoire est tellement liée à votre sentiment de productivité capitaliste.
Si on va mal, au fond c’est de notre faute, comme quand on est à la rue, ou qu’on a du mal à la traverser pour trouver un job.
Là où je vis, il n’y a parait-il que des fous et des boiteux… Mais Être bancal est une bénédiction : c’est être non rentable, non exploitable.

Il n’y a que perpétuelles injonctions au développement personnel, la start-up nation se conjugue au singulier, néo-libéralisme inoculé à notre corps, à notre esprit, chaque cellule de nous poussée à son plein potentiel pour mieux servir le marché. Rien ne se répand mieux sinon le cancer.
Celui-là même que les Casasnovas locaux n’ont pas de honte à conseiller d’affronter à coup de jus de légumes, parce qu’il faut se prendre en main, parce que bien sûr ta maladie tu en es responsable, tu te l’es fabriquée, incapable que tu es de n’avoir su dépasser les épreuves de ta vie et les avoir laissés te ronger.
Ça permet de ne pas se poser la question des causes environnementales ou des moyens donnés à la recherche pour guerroyer avec ce qui cause la moitié des décès de nos sociétés occidentales.
Alors qu’un bon smoothie choux-carottes…
Et la machine est heureuse comme quand on se culpabilise de notre propre empreinte écologique
Alors on peut se gausser de sauver son âme en achetant du bio au producteur. C’est obscène, mais plus facile que de lutter pour que nos politiques imposent aux industriels d’utiliser de meilleurs produits, et ainsi faire que les moins aisés profitent aussi de notre salvatrice prise de conscience.
Intéressant n’est-ce pas, mais moins Instragram compatible du coup.
« Tu vois pas qu’il faut renouer avec la nature ? »
C’est vrai qu’ils sont cons aussi ces pauvres, d’avoir cru que l’industrie était synonyme de progrès, alors qu’il y a une tisane pour tout. Surtout pour oublier. Autant de breuvages qui diluent la sensibilité à l’injustice.
Les afflictions, les démangeaisons comme le surplus de mauvaise graisse sont des signes des dysfonctionnements, des alertes que les problèmes ne sont pas réglés, faire disparaitre les conséquences reviendrait à enfouir les causes.
La douleur n’est qu’une information, mais une information cruciale pour nous dire que le mal est profond, et on ne l’efface pas en triant ses déchets ou en reprenant du quinoa.
Bien heureux celui qui pense qu’être vaut plus que faire, celui qui ne doit pas plus à la vie que d’exister, celui qui est sûr de s’aimer assez pour mériter d’aller bien, d’aller mieux, assez en paix pour se soigner.
Bien sûr que le la méditation apaise, mais quid quand rien que s’étirer le matin est impossible, assailli d’angoisses. Le temps se perd et le combat n’attend pas qu’on soit léger pour le mener. Il nous faut bien quelques personnes qui ne s’aiment pas assez pour sacrifier leur vie à croire qu’ils peuvent changer les choses. Un peu de romantisme quoi.
Votre recherche du parfait est si triste, le potentiel pleinement auto-exploité de chacun robotise nos actions jusqu’à la marge que le sytème veut bien nous laisser, tant qu’elle l’équilibre.
Mais sans souffrance pas de panache.

Pas la souffrance qu’on s’inflige petitement aux mollets quand on découvre le sport à 40 ans, ou celle qu’on inflige aux autres quand on leur conseille de faire pareil. Pas la souffrance qu’on choisit, pas celle dont on aime à dire qu’elle nous accompagne tous les jours pour se faire valoir.
Celle qui a jailli, explose pour ne laisser que le calme des cendres qui lentement planent jusqu’au sol. Étrange silence duquel paradoxalement tout devient possible. Tout à gagner puisque plus rien à perdre.
Ni cynisme, ni aigreur donc. Juste le serein constat que là où s’érigent les plus hauts monuments, qu’ils soient de sagesse ou même de joie, le poids des certitudes entrainera l’effondrement. Pour ne laisser que ruine.
Une ruine, aux artères obstruées d’éboulis d’usure. Une ruine qui a vu son peuple s’éloigner. Une ruine, vestige sur lequel le temps par la nature reprend ses droits.
Je suis une ruine.
Et libre à vous de me traverser, de m’arpenter, de me piétiner ou de me faire renaitre.
Mais je suis une ruine, aux fondations d’histoire et de contraintes, une ruine qu’on ne gentrifiera pas.
Benjamin Burtin, Février 2021