Sortir de sa condition de fille ou fils d’ouvrier et se sentir toujours appartenir au monde qui nous a vu naitre… Devenir haut-fonctionnaire et continuer à endosser les archétypes de son milieu d’origine… Ecrire un livre et ne pas pouvoir le faire lire à sa famille…
Comment s’affranchir des codes de la reproduction sociale et passer d’un milieu à l’autre sans culpabilité ?
La notion de « Transfuge » a interpellé Lucile Meunier, jeune journaliste montcellienne en exil à Paris pour ses études. Elle s’intéresse aux récits de vie de celles et ceux qui ont fait fi d’une certaine forme de fatalité. Celles et ceux pour qui l’ascension sociale est devenue une réalité, pacifiée ou au contraire génératrice de conflits intérieurs ou familiaux. Lucile lance un appel à témoignages et nous en avons profité pour faire sa connaissance.
Lucile, question facile, peux tu nous dire qui tu es ?
Quel est ton parcours ?
Je suis en train de finir ma dernière année d’étude en master 2 à l’école de journalisme de Sciences Po. Jai une spécialité de Journaliste Reporter d’Images (JRI), c’est-à-dire que j’apprends à filmer, monter, et bien sûr interviewer pour des formats télévisuels (sujets courts pour le JT, documentaires…), en plus d’une formation à l’écrit.
Je m’intéresse aussi aux nouvelles écritures sur le web, notamment dans le cadre de mon alternance pour Usbek & Rica, le magazine qui explore le futur (allez voir, c’est chouette !). On y fait de la prospective et nos sujets de prédilection sont le numérique et l’écologie. Chez eux, je m’occupe des vidéos et podcasts. Avant mon Master, j’ai fait une licence générale à Sciences Po. Et j’ai fait toute ma scolarité jusqu’à 18 ans à Montceau !
Plus tard, j’aimerais réaliser des documentaires ou continuer le journalisme sur le web.
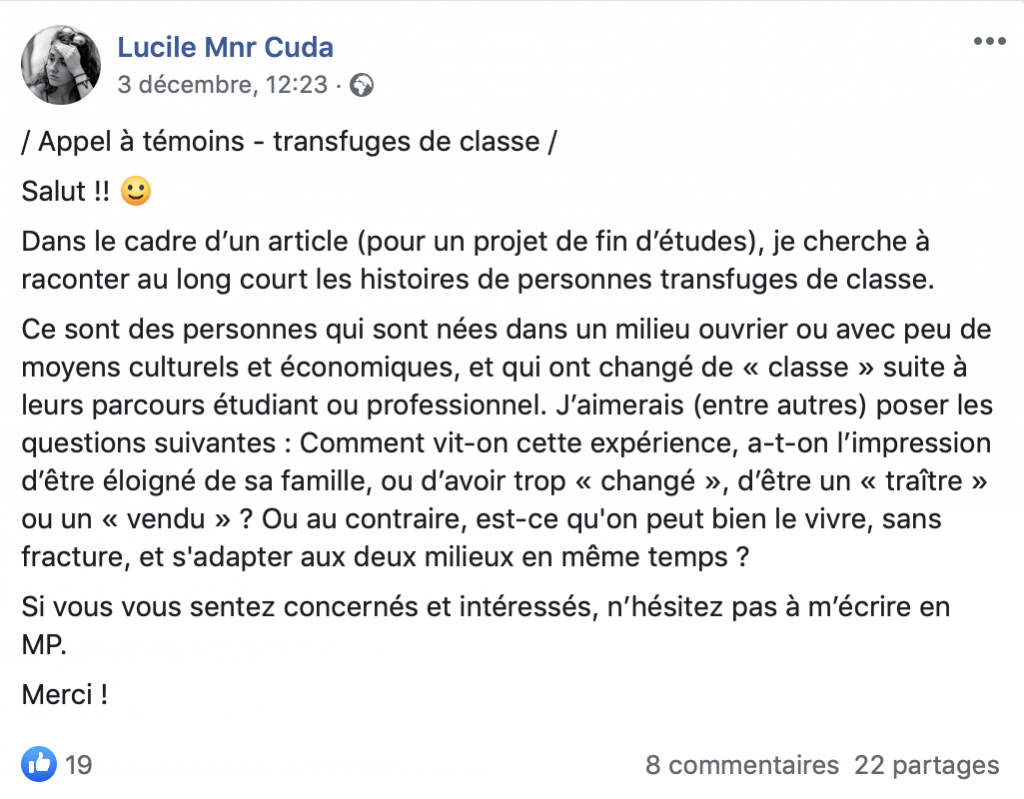
Il y a quelques temps, tu as lancé un appel à témoignages sur Facebook. « Transfuge de classe ». C’est un gros mot ?
Ça veut dire quoi exactement ?
Je ne me targuerais pas de donner une définition scientifique parfaite, n’étant pas sociologue. Mais on définit communément les transfuges de classe comme des personnes nées dans un milieu social défavorisé (pauvre, avec peu de ressources culturelles) et qui du fait de leur évolution personnelle, professionnelle, ou de leurs études, ont atteint une classe sociale « supérieure ».
Le parcours archétypal étant le fils d’ouvrier devenu cadre. Il existe des transfuges « descendants » (qui évoluent vers une classe sociale inférieure) mais dans ce reportage, je me concentre sur ce qu’on appelle « l’ascension sociale », en partant d’histoires concrètes, de témoignages.
Ces parcours étant souvent « radicaux » en termes de changement de vie, ce qui peut provoquer des malaises ou des chocs…
Pourquoi as-tu choisi ce sujet ?
En discutant avec beaucoup de transfuges – dont je fais moi même partie – je me suis rendue compte que le rapport qu’entretiennent ces personnes avec leur famille évolue beaucoup suite à ce changement de classe sociale.
Et certains travaux de sociologues comme Didier Eribon ou Edouard Louis m’ont particulièrement éclairée. On parle beaucoup des jeunes fils et filles d’ouvriers sur les bancs des grandes écoles et en entreprise, mais on se questionne moins souvent sur leur retour dans leur famille et leur milieu d’origine.
(…) le sentiment d’être coincés entre deux milieux sans n’appartenir à aucun d’entre eux (…)
Fierté extrême des parents et pression de réussir, incompatibilité des centres d’intérêts grandissante avec les proches… Certains continuent d’envoyer de l’argent à leurs parents mais s’en veulent d’habiter loin, ont peur d’être des « traîtres » à leur classe, des « vendus », en se lançant dans la finance ou le haut fonctionnariat.
D’autres ont le sentiment d’être coincés entre deux milieux sans n’appartenir à aucun d’entre eux, ou passent pour les « moralisateurs intello » lors des repas de famille sur certains sujets.
Pour d’autres, ça se passe plutôt sans encombre.

Les situations sont aussi diverses qu’il y a de personnes.
Parfois, l’adaptation se fait bien et dans d’autres cas, elle se fait dans la douleur. J’ai moi même vécu certains de ces malaises au fur et à mesure de mes études et c’est en enquêtant un peu que je me suis rendue compte de la fréquence de ce genre de situations… C’est très courant et ces sentiments sont souvent refoulés car le malaise dure longtemps avant de pouvoir entrer dans une phase plus saine et apaisée.
Ce qui m’intéresse ici, c’est de raconter les témoignages de ces personnes et de dépeindre la complexité de leurs rapports familiaux, à l’écrit et en vidéo. Ce sujet serait réalisé dans le cadre d’un projet de fin d’études (article numérique) pour mon école, rendu en mai.
J’essaierai de le publier dans un média d’ici là, en fonction des opportunités qui se présenteront à moi.
On parle de la fuite des cerveaux, des chercheurs qui quittent la France pour exercer leur profession et trouver des moyens à la hauteur de leurs ambitions. Tu as quitté Montceau pour faire tes études à Paris. On sait qu’il n’y a pas d’école de journalisme ici hein… Tu penses revenir un jour dans le Bassin Minier ? Quelles seraient les conditions pour que tu l’envisages ?
Oui, j’ai quitté Montceau par nécessité à une époque où mes professeurs ont cru en moi et ont poussé mes ambitions vers le haut. C’est une chance. J’ai longtemps cru que Montceau n’était pas une ville pour moi, aujourd’hui j’ai changé d’avis. En tant que journaliste, je remarque que la région est un nid infini de sujets. On pourrait faire un reportage sur chaque sujet d’ampleur nationale (emploi, culture, migrations…) en trouvant un exemple dans le coin. Mais on ne le fait pas assez, car on vit dans un pays trop centralisé.
En tant que journaliste, je remarque que la région est un nid infini de sujets.
Lucile
Aujourd’hui, il est compliqué pour moi de m’imaginer exercer ma profession ici si je veux en vivre. Si un média me fait confiance dans la région, je ne dirai pas non à cette aventure. Mais je pense que le problème est plus structurel que ça. Il faudrait surtout investir dans des médias de qualité au niveau local avec des journalistes confirmés (dédicace à ODIL) et délocaliser davantage les médias nationaux traditionnels. Quand on fait de la presse écrite, on peut facilement écrire pour des médias locaux. Mais quand on aime l’image comme moi, c’est déjà plus restreint. Mais pourquoi pas une école de journalisme à Montceau dans 10 ans ? Il faut avoir de l’ambition et s’investir quand on y croit. Je lance l’idée, pour ceux que ça intéresse !
Comment peut-on t’aider pour cet article ?
Si vous êtes concernés, ou croyez être concernés, si le sujet vous parle, n’hésitez pas à m’écrire et on pourra échanger. Tous les âges sont concernés ! Ça m’intéresse d’avoir des témoignages plus apaisés et de personnes qui ont réussi à s’adapter avec l’âge. Si l’idée vous plaît, vous pouvez aussi partager l’appel à témoin. Pour l’instant, je cherche juste à mieux comprendre ce phénomène et élargir mes horizons 🙂 Merci d’avance et peut-être à bientôt à Montceau !
Illustration de l’article : Collage par Anthony Zinono





